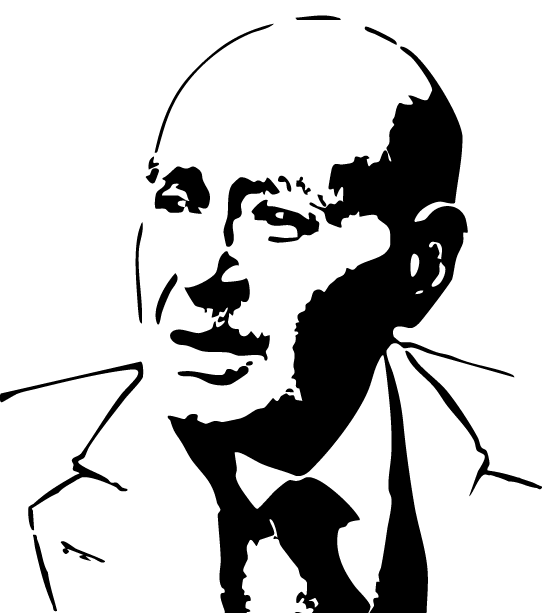
L’Atelier Albert Cohen est né en 1988, dans le sillage du premier colloque organisé en France sur l’œuvre d’Albert Cohen.
L’association se propose :
- D’organiser régulièrement des séances d’études sur l’œuvre d’Albert Cohen. Celles-ci ont longtemps pris la forme d’un séminaire (quatre à six séances annuelles) à l’Université de Paris VII. A partir de 2002, l’option retenue est celle d’une journée d’étude annuelle.
- Par souci de cohérence, les séances d’étude sont orientées par un sujet commun, redéfini chaque année : ce peut être un thème (le sacré, l’amour, le comique) ou une œuvre (Belle du Seigneur, Solal). L’Atelier reste néanmoins ouvert à des interventions extérieures au thème de l’année, présentant un intérêt particulier par leur nouveauté ou leur ampleur. Enfin, si l’orientation des études est généralement littéraire, l’Atelier donne toute sa place à d’autres approches, historiques, sociologiques ou philosophiques.
- De permettre à tous les chercheurs et étudiants d’accéder aux sources de documentation les plus larges. L’Atelier, dans cette perspective, met à la disposition de ses membres la quasi-totalité des documents publiés ou des travaux universitaires (du mémoire de maîtrise à la thèse) sur Albert Cohen depuis quinze ans. Il tient également ses membres régulièrement informés des dernières publications ou des manifestations culturelles à propos d’Albert Cohen.
- De publier chaque année des Cahiers Albert Cohen adressés gratuitement à ses membres ou vendus par correspondance. Les Cahierssont également disponibles dans certaines librairies.
L’Atelier est ouvert à tous. Les perspectives d’étude sont définies dans un esprit universitaire, à la fois exigeant et pluraliste. L’Atelier Albert Cohen, association culturelle, est indépendant de tout intérêt privé, éditorial, confessionnel ou politique.
ACTUALITES
-

Articles – Ariane : Belle du seigneur au théâtre
Ariane : Belle du seigneur au théâtre Entretien avec Olivier Borle , metteur en scène, par Catherine Milkovitch-Rioux Le spectacle ArianeD’après Belle du Seigneur d’Albert Cohen © Éditions…
-

Articles – Albert Cohen et Genève
Albert Cohen et Genève 5 décembre, 18h30 Vernissage du livre publié aux éditions La Baconnière, en présence des autrices et auteurs Pierre-Louis Chantre, Marie-Luce Desgrandchamps,…
-

Article – Mangeclous, une épopée truculente au Théâtre de la Renaissance
Culture : Mangeclous, une épopée truculente au Théâtre de la Renaissance PAR MATHIEU THAI Olivier Borle propose une adaptation du roman haut en couleur d’Albert Cohen,…

Bibliographie
TRAVAUX ET RECHERCHES
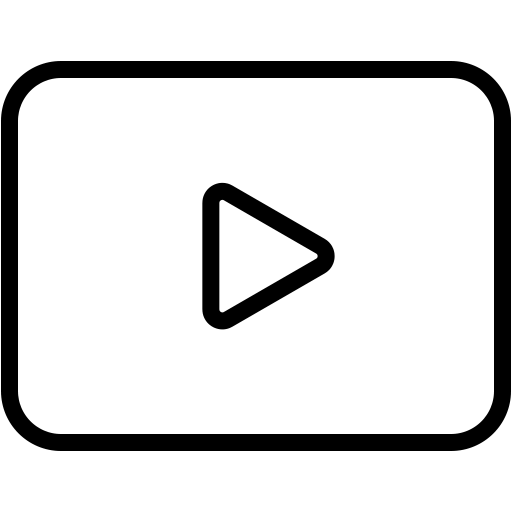
Journées d’études en vidéo
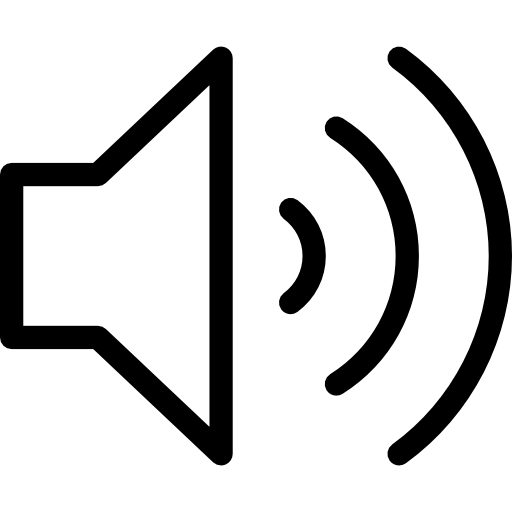
Conférences
audio
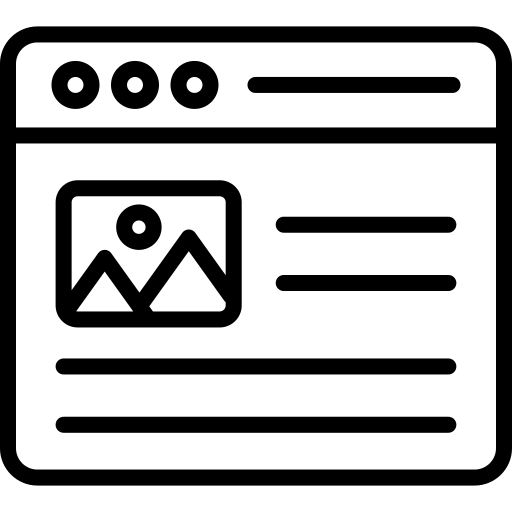
Articles
en ligne

Mémoires et travaux
universitaires
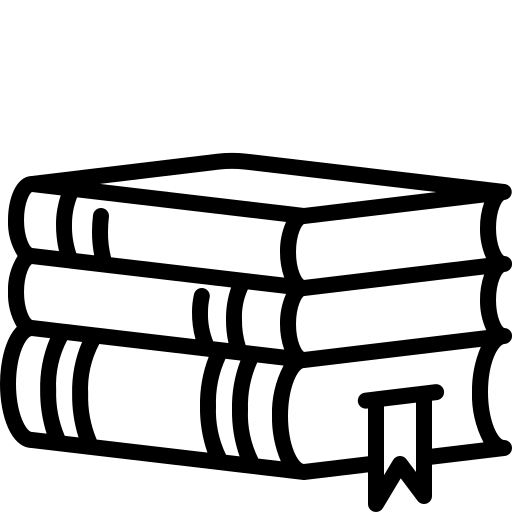
Thèse
et ouvrages
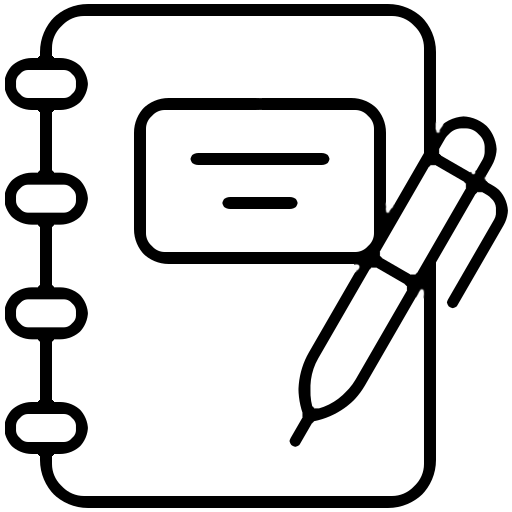
Travaux
en cours
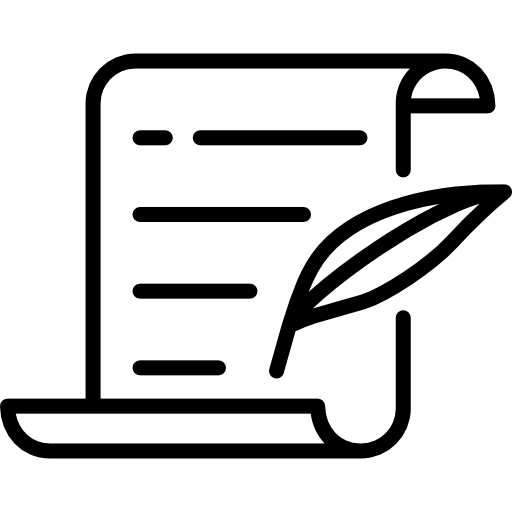
Comptes rendus d’ouvrages
DONNÉES
LEXICOMETRIQUES
